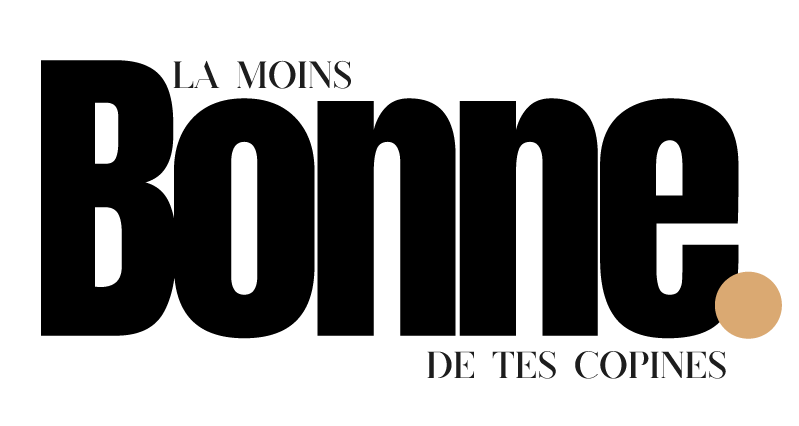Lundi 25 septembre 2023. Un début de semaine comme un autre, à savoir merdique. C’est pas nouveau : les lundis, je les déteste. Qu’ils soient lumineux ou pluvieux, avec un réveil tardif ou trop matinal, après une bonne nuit ou une insomnie, je les hais. J’ai jamais trop compris pourquoi. Quand j’étais salariée, c’était mon excuse. Après tout, ils annonçaient une nouvelle semaine, la fin du week-end, la fatigue qui s’accumule, le manque de temps et la routine. C’était de bonnes raisons. Mais maintenant, mes lundis, ils pourraient avoir une autre saveur, parce que je travaille de chez moi, avec mon Gégé à mes côtés, au rythme que je veux et comme je le veux. Je fais ce que bon me semble. Alors souvent, ils sont plutôt doux. Je prends mon temps, je bosse un peu, je me force jamais et je m’adapte à mon mood pourri. Et pourtant. Pourtant, je continue de les détester.

Malheureusement, ce lundi 25 septembre n’allait pas changer, car, sur mon téléphone, les notifications s’accumulaient, notamment celles d’une discussion que j’aime autant qu’elle peut m’énerver, tout comme les individus qui la composent : la conversation familiale. Sur WhatsApp, c’est assez commun, ce genre de groupe. Sauf si tu n’as pas de famille. Évidemment, là, c’est plus compliqué, et tu risques de détester cette nouvelle où je critique la mienne en oubliant la chance que j’ai.
Cette discussion, c’est à la fois des bonnes ondes avec des photos de chacun, des partages, de la légèreté et des anecdotes, mais c’est aussi beaucoup d’incompréhension, de répétitions, de malentendus et de fautes d’orthographe. Dans cet échange, plusieurs générations se confrontent et, visiblement, pour les parents, c’est un vrai challenge que d’utiliser le portable. Certes, je peux l’entendre, c’est pas inné pour tout le monde. Mais après plusieurs années de pratique, venant d’une mère parfois plus addict que moi à son téléphone, j’attendais une marge de progression plus importante. Car sur WhatsApp — prononcé à mon grand regret par mes deux géniteurs « WASAPP » —, c’est une vraie galère. Ma mère répond à ses propres messages, mon père fait des dictas de deux secondes avec pour contenu « Oh putain ça marche pas » et ma sœur réagit une fois sur six. Un enfer.

Le lundi 25 septembre, donc, la discussion débordait d’informations, mais une a retenu mon attention : « Nono, on peut venir ce vendredi pour le week-end ? On gardera ton neveu, en plus. »
Évidemment, à ce genre de demande, une seule option est envisageable : accepter. Car j’aurais pu mentir, dire que j’avais des choses de prévues, que je n’étais pas dispo et qu’en plus, j’étais en dépression à vouloir crever dans mon lit et disparaître. Mais une partie de moi se faisait une joie de voir mes parents et encore plus avec mon neveu. C’est toute la complexité des relations familiales. Je les aime autant qu’ils m’énervent. Alors forcément, j’ai accepté et j’en étais très heureuse.
Ce que je ne savais pas, ce que de deux nuits, nous allions passer à trois. Et trois, c’est trop. Sauf dans certaines situations. Mais dans ce cadre familial précisément, c’était trop. Parce que la maîtresse de mon neveu a trouvé bon, cette semaine du 25 septembre justement, de se vider par l’anus, de vomir ses tripes et surtout, de se mettre en arrêt pour deux jours, car malade. Je ne la blâme pas, la gastro. Mon neveu non plus. Et forcément, le jeudi, il a été foutu dans une autre classe, mais à 16 h 30, une fois que la cloche a retenti, ce sont ses grands-parents, aka mes parents, qui lui ont fait la surprise de le récupérer, et ils ont donc débarqué chez moi. De jeudi soir à dimanche soir. Presque quatre jours. Quatre jours à vivre ensemble. Dans mon cocon. Dans mon intimité.
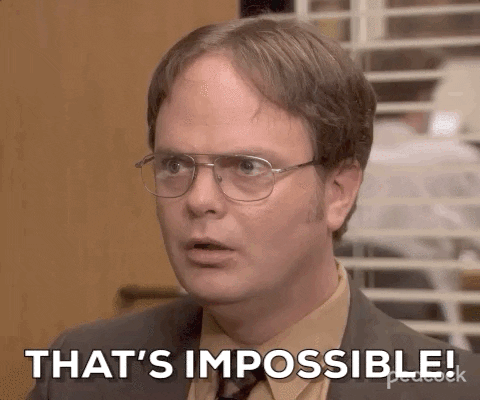
Dans un premier temps, il y a eu la mise en place.
Car, tout comme moi, les membres de ma famille, ce sont des farfelus. Pour faire simple, nous avions deux lits doubles et nous étions quatre, sans compter les deux chiens. Le calcul semble facile : deux dans un lit, deux dans l’autre. Ça, c’est sur le papier. Parce que dans les faits, mon père voulait absolument dormir seul. Sur un matelas gonflable. Dans la cuisine. Oui, mon père a passé la nuit dans la cuisine sur son lit gonflable alors qu’il y avait une place libre dans un lit pas gonflable. Ne cherchez pas. Farfelu, je vous dis.
Dans un deuxième temps, il y a eu l’entente. Pas toujours évidente. Encore moins avec un gamin de trois ans qui comprend un mot sur deux et parle en criant. Un enfant, ça te bouffe l’énergie, l’espace et ton goûter. Ça te bouffe tout. Mais à la limite, c’est mignon. Ce qui n’est pas forcément le cas d’un parent.
Dans un dernier temps, les activités. Au programme : week-end détente. Sur le papier, tout était parfait : la forêt, la crêperie trop généreuse en chantilly, la sieste en début d’aprèm, le goûter au soleil et le petit détour au centre équestre. Dans la réalité, même la promenade des chiens est devenue source de disputes. La laisse qui disparaît, les clés avec, la mère qui a envie de pisser juste avant de partir et le père qui est prêt depuis vingt minutes. Tout ça noyé dans l’amour et la joie de partager un moment ensemble. De quoi être schizophrène. En quelques secondes, on passait d’une crise à s’engueuler sans filtre et avec rage à un état de plénitude, soleil caressant le visage et hennissement des poneys en fond sonore.

La vérité, c’est que j’avais conscience de mes excès.
À chaque minute, je tentais de me raisonner et de me rappeler combien j’avais de la chance de vivre ce genre de moments. Mes parents à moi, ils sont géniaux. Certains d’entre vous les ont déjà rencontrés. Aimants, bienveillants, d’un soutien sans faille, toujours prêts à rendre service et à m’épauler dans mes folies. J’en suis hyper reconnaissante. Oui mais voilà, quand ils viennent chez moi, ou bien même quand je vais chez eux, la relation n’est pas la même. Sans qu’on sache pourquoi, il y a de la tension. Probablement à cause de mon mauvais caractère, mon côté vieille fille asociale qui vit seule depuis des années et mon seuil de tolérance vraiment réduit. C’est compliqué quand ils sont chez moi, alors que je me fais une joie de les recevoir.
Je deviens donc deux personnes différentes. Celle capable de leur préparer un repas incroyable, mais celle qui ne veut même pas sortir les chips pour l’apéro. Celle qui leur fait le lit avec soin, mais celle qui gueule lorsqu’ils me demandent où est la serviette. Celle qui leur pose des questions, mais qui n’écoute pas les réponses. Celle qui a envie de leur confier tous ses secrets, mais qui se contente de faire parler l’égo. Parce que c’est ça, la difficulté avec les parents. C’est que tu es à la fois une femme indépendante, adulte, avec ses propres difficultés dans la société, et à la fois, tu seras toujours leur petite fille qui rêverait de s’effondrer en leur racontant ses peines de cœur ou ses chamailleries avec ses potes.

Sur le canapé, ils étaient là, tous les deux, à m’écouter. À la moindre de leur phrase, je m’énervais, ne leur laissant pas même la chance de la terminer. J’étais exigeante, plus qu’avec personne. J’étais dure, plus qu’avec personne. Je ne leur épargnais rien. Alors qu’ils sont probablement ceux que j’aime le plus sur cette Terre. C’est donc ça, devenir adulte : adorer ses parents autant qu’ils nous insupportent. Parce que parfois, ils sont dépassés, à côté de la plaque, il faut leur répéter cent fois les choses avant qu’ils ne les comprennent, et pourtant, on continue de le faire. Car on a toujours besoin d’eux, même s’ils n’ont pas tout le contexte et que leurs conseils ne sont pas si bons. Ils restent nos parents, ceux qui nous ont donné la vie. Cette vie que j’aime autant que je déteste et qui, finalement, est une parfaite métaphore de ma relation avec eux. Qui est si précieuse. Qui peut disparaître si vite. Qu’il faut chérir. Qu’on peut critiquer sans honte. Qui est complexe. Qui est nous tous. C’est ce que j’ai compris, ce jour où j’ai aimé détester mes parents.